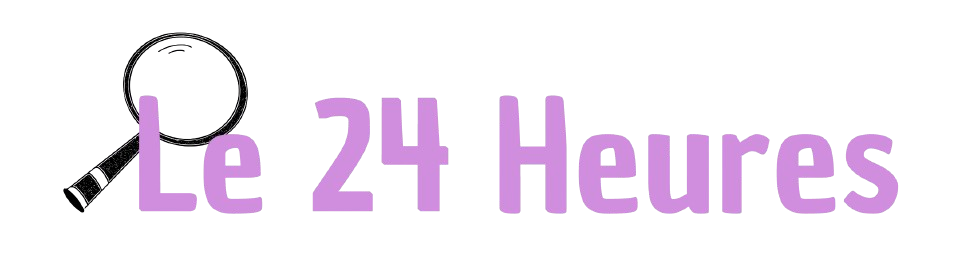Construit au XVIIIe siècle, le château de Merville traverse les époques avec une élégance intacte. Témoin de la grande histoire comme des petites anecdotes familiales, il continue de fasciner les visiteurs, entre patrimoine, mémoire et défis contemporains.
Une demeure née d’une ambition familiale
À une vingtaine de kilomètres de Toulouse, le château de Merville se dresse fièrement au cœur d’un domaine verdoyant. Son histoire commence en 1743, lorsque le marquis de Chalvet-Rochemonteix, conseiller au Parlement de Toulouse, décide d’ériger une demeure à la hauteur de son rang. Il fait raser deux maisons fortes pour bâtir un château dans l’esprit du siècle des Lumières : symétrie parfaite, vastes salons en enfilade et façades en briques roses, typiques de la région toulousaine.


Ce n’est pas un simple château d’apparat. Le marquis veut une demeure où cohabitent raffinement et fonctionnalité, entre influences urbaines et rurales. Il choisit d’ouvrir la bâtisse sur la nature environnante, concevant un parc soigneusement aménagé. Pour ériger ce château, pas moins de 300 000 briques sont nécessaires, extraites des terres alentour. « L’ensemble est parfaitement aligné du rez-de-chaussée aux étages », souligne Laurent de Beaumont, propriétaire actuel.
Les fastes de la Restauration
Après la Révolution française, où de nombreux châteaux sont pillés ou détruits, celui de Merville parvient à traverser la tempête. Mieux encore, sous la Restauration (1814-1830), il devient un lieu de prestige. Des ministres de Charles X y sont reçus dans des salons ornés de boiseries et de cheminées en marbre.
Mais avec les bouleversements politiques du XIXe siècle, le château voit son destin évoluer. Les grandes réceptions se font plus rares, et peu à peu, il entre dans une phase plus discrète de son histoire.
Une transformation sous l’ère agricole
Au début du XXe siècle, sous l’impulsion du grand-père de l’actuel propriétaire, le château prend une toute autre fonction : il devient le cœur d’une exploitation agricole. Les vastes pièces autrefois dédiées aux festivités accueillent des équipements, et les terres du domaine sont mises à contribution pour la culture et l’élevage.
« C’était une période où il fallait s’adapter », raconte Laurent de Beaumont. « Le château a toujours dû évoluer avec son temps pour survivre. » Cette capacité à se réinventer sera l’une des clés de sa pérennité.

Un défi permanent pour la conservation
Aujourd’hui, le château de Merville a trouvé une nouvelle vocation, celle du tourisme et de l’événementiel. Accueillant chaque année 35 000 à 40 000 visiteurs de pâque à la Toussaint , il s’impose comme un site incontournable pour les familles et les écoles de la région toulousaine.
Mais entretenir un tel monument est un défi constant. « Les recettes des visiteurs permettent d’assurer l’entretien quotidien des salons et de financer quelques travaux », explique Laurent de Beaumont. Toutefois, les rénovations majeures, comme la restauration des toitures ou des façades, nécessitent des financements plus conséquents. La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) intervient pour environ 40 % des coûts, mais 60 % restent à la charge des propriétaires.
Les caprices du climat compliquent encore la tâche. « Les tempêtes de 1999 et 2009 ont causé d’importants dégâts, notamment la destruction de toiture” raconte le propriétaire. Même l’entretien des volets est devenu une charge lourde : « Autrefois, on peignait tous les 30 ans, aujourd’hui, c’est tous les 5 à 10 ans. »

Un château pour les générations futures
Malgré les défis, la famille Beaumont reste animée par une volonté : transmettre ce patrimoine intact aux générations futures. « Ce château a toujours appartenu à notre famille et nous espérons qu’il le restera », confie Laurent de Beaumont avec émotion.
Préserver ce lieu tout en le faisant vivre au présent, c’est le défi de la famille. Et en arpentant ses salons ou en flânant dans le parc, on mesure tout ce que Merville a à raconter.